Les gens qui détestent les aéroports ne voient pas ce qui les rend magiques
Chaque jour, plus de 3 millions d'Américains prennent44 000 volsà travers29 millions kilomètres carrés d'espace aérien. Nous mettons de petites bouteilles de lotion dans des sacs zippés de la taille d'un quart, appelons une voiture avec nos téléphones, imprimons un ticket dans un kiosque, envoyons toutes nos affaires par un couloir et restons sans chaussures ni veste, les bras levés au-dessus de nos têtes. Et puis nous sommes là, dans le terminal, à la merci des compagnies aériennes et de l'aéroport lui-même, endurant un espace où nous avons très peu de contrôle, sentant le temps passer.
Les aéroports sont des lieux à la fois d’extrême urgence et d’ennui punitif. Ce sont des endroits où nous nous sentons proches de la mort.quelques étudesrapportent que près de 40 % d’entre nous ont peur de prendre l’avion – et ils nous donnent également le sentiment d’être soumis aux caprices de bureaucraties banales échappant à notre contrôle. Presque20 pour centde tous les vols sont retardés chaque année, nous passons donc de nombreuses heures que nous n'avions pas prévues à attendre dans les terminaux à travers le pays à manger des bonbons que nous avons achetés de manière impulsive et à chercher un endroit pour brancher nos téléphones.
Le premier endroit où je me suis assis en attendant un vol était l'aéroport de Détroit dans les années 1990, alors un enfer miteux de plafonds bas, de lumières fluorescentes bourdonnantes et de sièges orange en plastique dur. Comme tant d’aéroports, ce n’était pas un lieu conçu pour le plaisir ou le repos, mais plutôt un lieu qui donnait envie de fuir, un lieu qu’il fallait endurer. Ou du moins c’est comme ça que je m’en souviens. Quand j'étais enfant, ma famille prenait rarement l'avion, mais mes parents, qui étaient des enfants de la banlieue de Détroit, me régalaient d'histoires d'enfants qu'ils connaissaient qui montaient sur le carrousel à bagages ou essayaient de monter à bord d'avions au hasard pour s'amuser. Pour eux, l’aéroport respirait encore la magie des premières années du transport aérien de passagers. Le fait même que n’importe qui puisse voler n’importe où ressemblait à un miracle.
Mon souvenir dominant de cet aéroport est celui de mon départ pour un voyage d'études secondaires à Londres – une période financière et émotionnelle pour ma famille. Alors que j'étais assis sur le tarmac, reconnaissant d'être enfin loin des chaises rousses, une hôtesse de l'air s'est précipitée dans l'allée et m'a remis une carte de prière. Ma grand-mère sicilienne s'était rendue à l'aéroport en voiture et l'avait supplié de me le donner, terrifiée à l'idée de ne pas survivre à la traversée de l'Atlantique sans l'aide divine. À ce moment-là, j’avais l’impression que je ne pourrais jamais sortir de l’endroit où j’ai grandi, comme si quelqu’un s’accrocherait toujours à l’aile.
Le sentiment que j’avais alors – d’être coincé entre deux lieux, ne voulant pas rester et incapable de partir – est un sentiment que les aéroports physiqueisent. Ce sont des espaces liminaires par excellence, terme architectural emprunté à l’anthropologie, où liminal désigne la partie médiane d’un rite de passage. La phase liminale est l’intervalle entre une identité que vous avez quittée et celle que vous n’êtes pas encore devenue, le moment où un couple est fiancé mais pas encore marié, où le pèlerin est parti en voyage mais n’a pas encore atteint le sanctuaire sacré. Ces parties de notre vie sont anxieuses. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite, qui nous serons. La stabilité de notre passé et de notre avenir est tout simplement hors de portée.
Les aéroports sont également des lieux où les identités se dissolvent et où l’incertitude règne. Les points d’ancrage qui nous retiennent – nos familles, nos maisons, nos emplois – peuvent sembler lointains dans un aéroport. Arriverons-nous là où nous allons ? Qui serons-nous à notre arrivée ? Passer du temps entre le départ et l’arrivée est désorientant. Nous guérissons notre anxiété avec des cocktails à Margaritaville et des romans trash achetés à la librairie de l'aéroport, en essayant de supporter l'espace intermédiaire de l'inconnaissance.
Cette liminalité peut aussi être passionnante. Même si rien n’est sûr, tout est possible.
Mais cette liminalité peut aussi être passionnante. Même si rien n’est sûr, tout est possible. C’est ce sentiment de possibilité que j’ai commencé à ressentir à propos de l’aéroport de Détroit au début. Les terminaux avaient été récemment rénovés pour avoir de hauts plafonds, de nombreux coins salons et d'énormes baies vitrées qui rendaient le ciel gris du Michigan lumineux tout au long de l'hiver. Dans le couloir principal, une fontaine projetait des jets d'eau colorés dans les airs et un pianiste jouait de la musique classique et des airs de spectacle. Un passage souterrain entre les halls offrait un affichage de lumière laser et un paysage sonore minimaliste Eno-esque que j'ai trouvé à la fois bizarre et apaisant.
Parfois, je faisais des allers-retours sur le tapis roulant à travers ce tunnel pendant une demi-heure en attendant un vol, mon humeur adoucie par le spectacle de lumière comme un stoner dans les années 1970. Un tramway intérieur transportait les passagers d'un bout à l'autre du terminal, en passant devant l'énorme librairie remplie de best-sellers et de magazines gonflés, les boutiques hors taxes haut de gamme qui vendaient des parfums de créateurs et des cosmétiques MAC, et le restaurant de sushi que tout le monde jurait être bon parce que le poisson provenait des vols en provenance de Seattle et du Japon. Cet endroit que j'avais autrefois détesté, qui avait l'impression de me retenir, était devenu beau, ambitieux et grandiose.
À l'université, je me rendais à l'aéroport en voiture avec des amis, récupérant des colocataires revenant d'études à l'étranger ou déposant d'autres personnes embarquant sur des vols pour visiter des endroits qui semblaient autrefois n'exister que dans les romans et les films : Los Angeles, Dublin, Vermont. Un jour, ma meilleure amie Jane, fraîchement sortie d'un programme d'un an à Aix-en-Provence, a garé la voiture et est venue avec moi au guichet pour m'accompagner lors d'un voyage chez un vieil ami de lycée à Manhattan. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait pris la peine de venir, elle a répondu : "J'aime être ici et voir tous les endroits où les gens vont. Cela me donne l'impression que nous pourrions tous partir."
Chaque fois que je suis à l'aéroport, je pense à Jane et j'envisage les différentes possibilités en me dirigeant vers ma porte d'embarquement. Houston. Rio. Bangkok. Londres. Cincinnati. Quelle version de la vie m’emmènerait dans chacun de ces endroits ? À qui devrais-je rendre visite et que laisserais-je derrière moi ? Et peut-être le plus excitant de tous : et si je me dirigeais vers le comptoir et achetais un billet ? Et si je partais ?
À Noël dernier, j'ai été bloquée à mon aéroport bien-aimé de Détroit pendant huit heures alors que je me rendais chez mes parents avec mon mari et ma fille de deux ans. Nous avions quitté New York, où nous vivons, et notre vol de correspondance vers Traverse City, dans le Michigan, avait été annulé. Lorsque l’alerte est apparue sur mon téléphone concernant l’annulation, j’ai ressenti tous les sentiments habituels à l’aéroport : je m’inquiétais de l’horaire de sommeil de ma fille et j’ai ressenti l’écrasement des heures que nous devions occuper, je m’ennuyais et je ne savais pas si notre prochain vol partirait.
Après avoir regardé la fontaine, pris le tram et traversé le tunnel, j'ai accompagné ma fille dans un couloir dans sa poussette, en espérant que le mouvement l'endormirait. Entre la Tap Room de Cat Cora et le magasin de fournitures de golf, j’ai vu une enseigne indiquant une salle de soins infirmiers – l’un des nouveaux équipements issus de la rénovation de l’aéroport, mais que je n’avais remarqué que maintenant que j’avais un bébé. J'ai frappé à la porte et comme personne n'a répondu, nous nous sommes glissés à l'intérieur. C’était comme si nous avions sorti un livre sur une étagère de bibliothèque et qu’une chambre cachée s’était ouverte, visible uniquement pour moi maintenant que j’étais mère. La pièce était sombre et calme, avec un fauteuil inclinable placé pour regarder par une grande baie vitrée. Nous avions trouvé le calme au milieu des lumières vives et des téléviseurs hurlants.
Je me suis assis sur la chaise et j'ai tenu ma fille près de moi, la berçant et chantant doucement « Twinkle, Twinkle, Little Star », la voulant dormir. Tout en chantant, j'ai regardé par la fenêtre la piste et j'ai regardé les avions décoller, un à un, leurs petits feux rouges montant à travers les nuages, pleins de passagers quittant enfin la dissonance temporaire du terminal où commence tout voyage aérien. Je me tenais très immobile sur le fauteuil inclinable en vinyle gris, incapable de faire autre chose que d'attendre : que ma fille dorme, que mon vol soit appelé, que l'accord de la journée se résolve enfin pour que je puisse savoir ce qui allait se passer ensuite.
Subscription
Enter your email address to subscribe to the site and receive notifications of new posts by email.
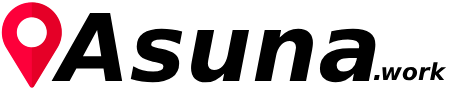
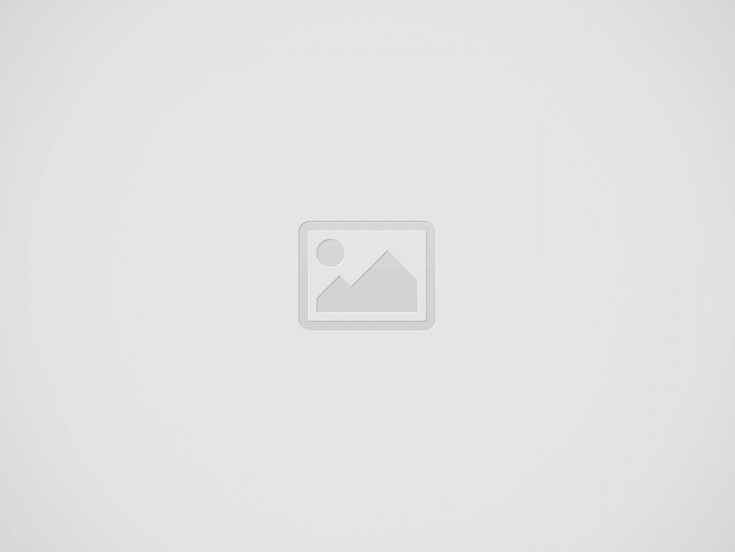










:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-748337295-5bca071946e0fb00265dcb18-e00db3d7c71543719936c7259812aab2.jpg)


